Rentabilité et sécurisation d’un secteur : quand le mieux devient l’ennemi du bien
La distorsion vint d’ailleurs. On nous avait bien appris cette dimension raisonnée, économique et sanitaire du vétérinaire rural. On ne soigne pas une vache comme un cheval ou un caniche. Cet animal s’intègre dans une chaine alimentaire qu’il faut rentabiliser et sécuriser. C’était le deal et on le savait. On était même fier de mettre notre science au service du bien commun. Mais, petit à petit, ces deux éléments ont pris une ampleur qui a surpassé la médecine rurale et nos rêves de terroir.
Avec la crise de la vache folle, la sécurité alimentaire est remontée d’un cran. On a imposé toujours plus de contrôles, de plus en plus précis, pour éliminer les risques pour l’animal et le consommateur. C’était plutôt bénéfique sur le principe, mais la réalité s’est révélée très lourde dans sa mise en place : allongement des délais d’introduction, multiplication des prélèvements de contrôle et des vaccinations, plan d’éradication, pertes de certaines primes. Si la dimension sanitaire était indiscutable, la stratégie mise en place jouait surtout le jeu du commerce international plutôt que le bénéfice de l’animal lui-même ? Les animaux vaccinés et testés prirent les camions pour être engraissés en Italie ou en Espagne car « c’était moins cher là-bas », du moins c’était ce qu’on fit croire aux éleveurs. Faisant fi de la souffrance animale et de la pollution environnementale, il fallait produire, plus et plus sain.
Qu’en est-il alors des conséquences sur les acteurs du secteur et leurs relations ?
Les leviers de pressions sur les agriculteurs sont nombreux et insidieux : primes, pressions des syndicats majoritaires (90 % des chambres d’agricultures sont dirigées par un seul syndicat), conjoncture mondiale. L’agriculteur devint plus entrepreneur que paysan, sur des surfaces toujours plus grandes avec beaucoup d’animaux, que l’on connait moins, que l’on voit moins. Alors oui la technologie leur offre la possibilité d’avoir des caméras « face time », des systèmes électroniques qui font sonner les portables quand la vache est en chaleurs, quand elle va mettre bas, quand le robot de traite détecte une anomalie.
Dans ces grandes stabulations modernes, recouvertes de panneaux photovoltaïques, le vétérinaire seul, cherche la vache malade. L’agriculteur l’a bloquée au cornadis, il n’est pas là, il est ailleurs, on l’appellera, on laissera l’ordonnance dans le bureau, on repassera. On était un conseiller, un proche, de ceux qu’on n’aime pas trop voir tout de même, parfois un ami. On devint un prestataire de service. On permet de fonctionner, on contrôle, on délivre des médicaments. Le suivi régulier et attesté d’une exploitation lui permet de les obtenir " au comptoir", sans forcément qu’il y ait de visite. C’est d'ailleurs pour le vétérinaire rural, les seuls « actes » rentables ; tout le reste, le suivi, les interventions sont largement sous tarifés pour des raisons conjoncturelles. L’agriculteur ne pourrait pas payer le vrai prix. Et on ne lui paye pas non plus son travail le prix qu’il vaut alors...
L’activité de conseil s’émiette entre les techniciens des marchands d’aliment ou du contrôle laitier, des centres d’insémination. Le vétérinaire conseille aussi, et souvent mieux, mais il est plus cher. Et c’est tellement difficile qu’il faut rogner de partout, même dans la confiance qu’on lui accorde. Si un animal meurt, même si l’éleveur n’a pas de doute sur l’énergie et la méthode déployée par le vétérinaire pour essayer de le sauver, on le " mettra à l’assurance", histoire de payer la bête. C’est comme ça. Les discussions, les cafés au coin du poêle, après avoir laissé ses bottes à l’entrée, sont de moins en moins fréquents et de plus en plus court. Pas le temps. Plus le temps de créer un vrai lien avec ses bêtes, ni avec celui qui les soigne. Des questions restent sans réponse " Est ce que ce veau a bu son colostrum?" "Depuis quand cette vache ne rumine plus?" On ne sait pas, on n’était pas là.
Et le rêve devient cauchemar…
Parfois le désespoir l’emporte. Tout s’effrite, tout disjoncte. La souffrance humaine rejoint celle des animaux, enfin, mais trop tard. On sent la pression qui monte, la gorge qui se serre en entrant dans cette étable sale où les animaux errent dans le fumier jusqu’ au genou. Et on voit cette poutre, cette large poutre où un jour cet homme, qu’on a vidé de ses rêves de paysan, accrochera une corde. Un agriculteur se suicide tous les deux jours en France aujourd'hui. Ce n’est plus un chiffre, c’est un génocide.
Le vétérinaire sera là quand même. La nuit, le week-end, sous la neige, sous la pluie, toujours plus loin. Eux aussi se fatiguent, ont envie de lever le pied mais la relève se fait attendre. Est-ce que les jeunes n’ont plus envie de terroir, d’être au cœur d’une économie de territoire, de faire la part belle à la nature en faisant un travail indiscutablement indispensable ? Si, bien sûr, ça les fait même toujours rêver, mais pas longtemps. Le problème évoqué d’un recrutement trop « intellectualisé et urbain » est minoritaire. Un non-dit sur la féminisation persiste, il est dissimulé mais il est lourd de sous-entendus. Le fait d’être une femme issue du milieu urbain, ce que je suis, n’est absolument pas un frein. Le fait d’avoir un cerveau fonctionnel non plus. La dérive paternaliste et sexiste de la « femme trop éduquée » a la dent dure ! Ce qui crée la défection c’est la perte du rêve, pas le rêve utopique irréalisable d’une vie professionnelle parfaite, mais celui de faire partie d’une vie communautaire rurale. Et malheureusement, la part de ce qui faisait la chaleur de cette vie de campagne, de ces poignées de main rugueuses diminue. Jour après jour, on ne voit plus que la carence de sommeil, les kilomètres engloutis, les heures loin des siens, les factures impayées. Le bonheur de sortir un veau au petit matin s’étiole et ne tient plus le reste. On essaie d’organiser, on se regroupe, on fait des tournées, on partage les gardes mais parfois ce n’est pas suffisant. Pas suffisant pour lutter contre l’envie d’un salaire plus élevé, enfin en rapport avec le niveau de qualification, comme le propose l’industrie pharmaceutique ou agro-alimentaire, d’un confort de travail et d’une rentabilité comme en exercice canin. On jette l’éponge peut être plus vite chez les jeunes, les enfants du millénium ont peut-être plus soif d’épanouissement personnel et s’il ne peut être trouvé dans le travail, en raison de l’accumulation des déconvenues par opposition à l’attendu, ils vont le chercher ailleurs que dans nos campagnes qui se vident.
Mais la prise de conscience ne se limite pas à la seule pénibilité du métier !
Vient probablement s’ajouter à tout ça, une certaine conscience de la dégradation de notre environnement, de la relation de l’agriculture intensive avec la perte de la biodiversité et le réchauffement climatique et ne pas avoir envie de faire partie de cela, d’être un des maillons du système. D’essayer en vain de corriger des rations trop riches à base de soja transgénique et de maïs, gros consommateurs d’eau et de produits phyto sanitaires puis de soigner des vaches malades de cette surproductivité imposée. De soigner des veaux immunodéprimés à cause d’une alimentation inepte mais élaborée pour une croissance maximum et un désir du consommateur d’avoir une viande laiteuse. Parce qu’on sait mieux que personne, ce qu’est la souffrance animale et que le rythme et l’environnement imposés par certaines productions sont simplement incompatibles avec la notion, enseignée à présent dans toutes les écoles vétérinaires, de bien-être animal. Parce qu’on se rend compte que parfois cet animal de ferme n’est plus que le sous-produit des primes qu’il engendre, et donc que le fait de le soigner devient très aléatoire.
Est-ce que l’on veut vraiment être complice d’un système qui nous révulse et où notre impact devient de plus en plus sécuritaire et nous éloigne de l’animal, celui-là même par lequel on est venu à cette profession ? Et la détresse humaine ? Peut-on supporter de voir des gens que l’on apprécie, que l’on a essayé d’épauler au mieux, s’enfoncer dans un cercle insidieux d’échec et de misère physique, psychique et sociale, parfois jusqu’à la mort, laissant des étables vides et des familles brisées ? Comment peut-on ignorer que l’accumulation de tant de contradictions et de contraintes ne conduisent à la fuite ? Combien de temps peut-on regarder ailleurs alors que la maison brûle, pour paraphraser certains ?
Malgré tout, l’espoir existe !
Il y a pourtant encore des résistants, des deux côtés. Des paysans fiers de leurs petites structures, de la proximité de leurs bêtes, de leur rupture avec la doctrine générale de l’hyper productivité. Des gens qui tiennent compte de l’évolution du climat, de la dégradation dramatique de sols ruinés par les produits phytosanitaires. Qui redécouvrent, avec tout l’apport de la technologie actuelle, sans retourner au moyen-âge agraire, la vertu des cycles biologiques et de leur équilibre, des mélanges céréales et protéagineuses locales. Qui savent qu’une bête qui est nourrie et qui vit en fonction de ses besoins physiologiques peut produire, certes un peu moins, mais plus longtemps et sans maladie. Et qu’aucun outil technologique ne remplacera l’œil et la main de l’éleveur, qui voit un port de tête anormal, une démarche inhabituelle, qui touche un poil piqué, un mufle fiévreux. « Elle n’est pas comme d’habitude, Docteur ! » Mais pour prononcer cette phrase, si juste de sens, faut-il encore connaitre le quotidien de la bête que l’on soigne, pour en voir la moindre altération... Oui il reste de ceux-là et ce ne sont pas que des hippies hirsutes et adeptes de la décroissance et de l’autosuffisance. Ce sont la plupart du temps des paysans qui ont gardé un des sens premiers de leur existence : le bon sens. Il reste encore des vétérinaires qui mettront les bottes coûte que coûte, et préfèreront faire des bornes pour des clous, plutôt que de soigner des chiens dans le confort d’un cabinet. Et ce ne sont pas uniquement des hommes d’âge mûrs au physique de rugbymen, ce sont juste des vétos qui ont envie de faire leur boulot. Qui zapperont l’anniversaire du petit dernier pour aller sortir un veau, au fond d’un pré en pente, sous la pluie. Qui serreront les dents en allant soigner une vache chez un gars dont la dette dépasse largement le salaire mensuel du praticien. Parce que la bête, elle n’y est pour rien, elle.
Et les bêtes et la terre, c’est tout ce qui compte pour ceux-là, ce qui ont choisi de ne pas encore baisser les bras. Oui ça existe encore, mais il est légitime de se demander combien de temps, le rêve fragile des uns fera tenir la foi vacillante des autres.
Combien de temps on mettra sur le compte d’un recrutement ou d’un enseignement défaillant, le simple fait qu’il est difficile de pousser quelqu’un qui a fait le choix du vivant d’aller en sens inverse de ses convictions, au détriment de son équilibre personnel ? Car tout autant, sinon peut être plus encore que ses confrères, le vétérinaire rural est un amoureux de la vie, de la vie animale, de la vie végétale, de l’équilibre du vivant et de l’interaction homme-animal, qu’il aide à bonifier depuis des siècles. Quel est alors le but de sa pérennité, si sa raison d’être est pervertie en quelque chose auquel il ne peut plus croire, avec toute la force nécessaire pour en surmonter les difficultés ?
Vanessa Fuks,
Vétérinaire
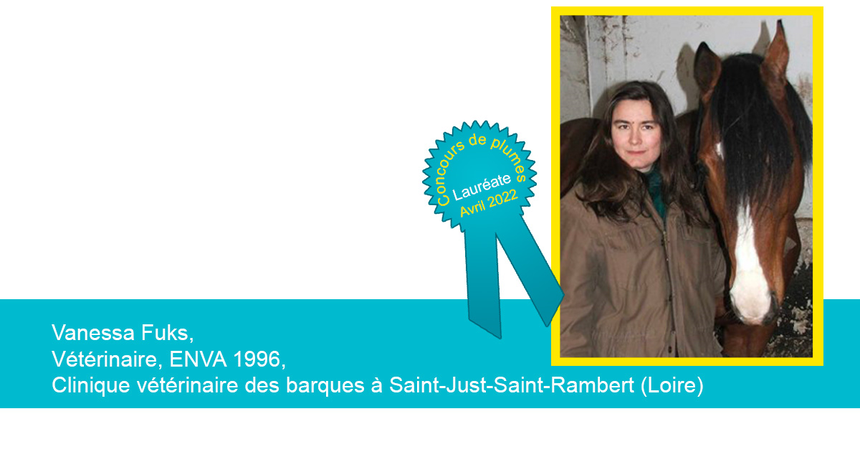
Crédit photo : @ Vanessa Fuks







